Coupable ou tragique ?
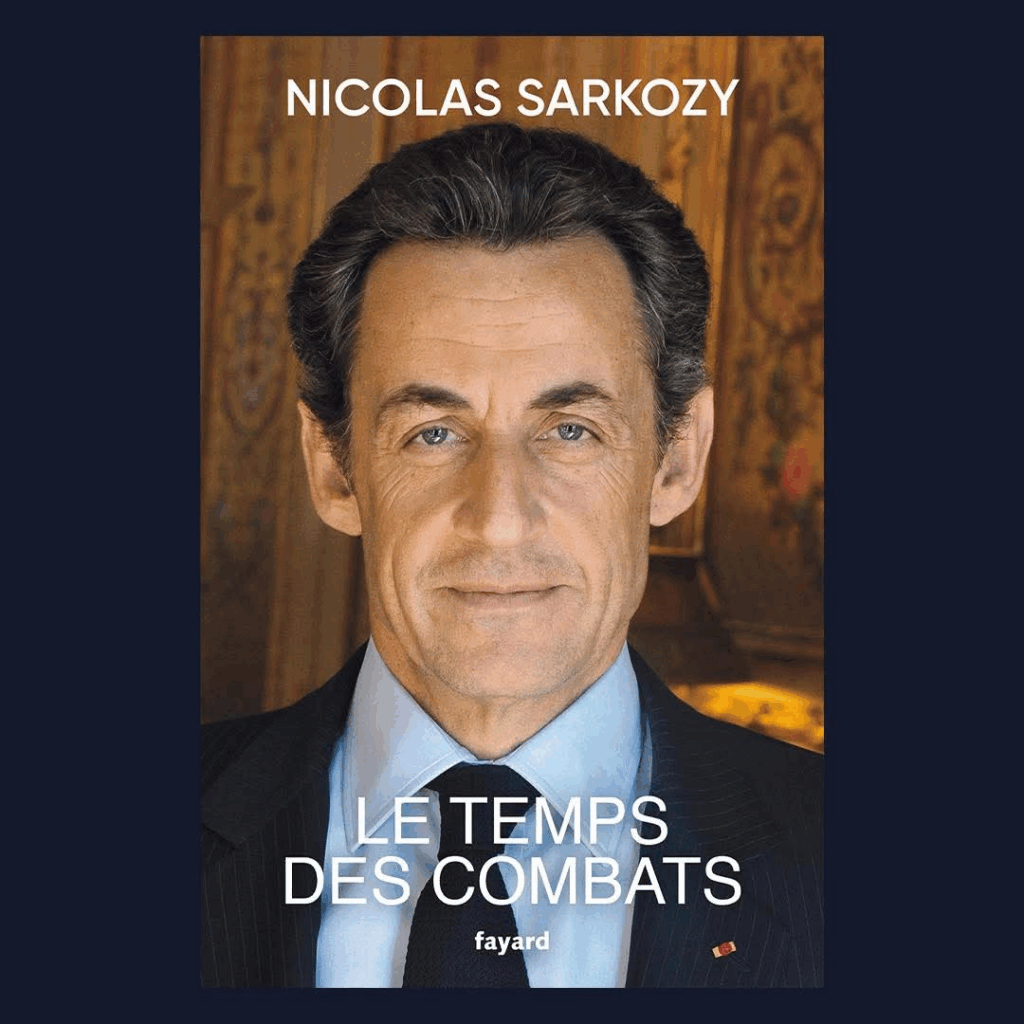
Réflexion sur la liberté, la faute et le destin à l’ombre du procès Sarkozy
Par Chérif Sampiring Diallo Journaliste, Éditorialiste, Écrivain, Essayiste
La sentence est tombée : cinq ans de prison pour un ancien chef d’État. Mais derrière les procédures, une interrogation plus ancienne se dresse : qu’est-ce qu’« être coupable » ?
Est-ce commettre un acte répréhensible ? Ou bien se trouver emporté par une nécessité qui nous dépasse ?
Entre liberté et déterminisme
Le droit, héritier des Lumières, affirme que l’homme est libre et donc responsable. Condamner Nicolas Sarkozy, c’est réaffirmer que, quelles que soient les contraintes du pouvoir, il aurait pu choisir autrement.
Pourtant, la philosophie nous rappelle la complexité du réel. Spinoza voyait dans chaque action humaine le fruit d’une infinité de causes ; Hegel parlait de la « ruse de la raison » qui utilise les individus pour faire advenir l’Histoire. Dans cette perspective, un dirigeant n’est peut-être que l’instrument d’un mouvement plus vaste : ambition d’un parti, logique d’un système électoral avide d’argent, inertie des réseaux d’influence. Si tout est nécessité, que vaut le verbe « faute » ?
La tentation du destin
Les tragédies grecques nous enseignent qu’on peut être innocent juridiquement et néanmoins « coupable » aux yeux du destin. Œdipe n’avait pas voulu tuer son père ; il accomplit pourtant la prophétie. Sarkozy, figure d’un volontarisme presque mythologique, n’incarne-t-il pas ce héros qui croit plier le monde à sa volonté mais que rattrape un enchaînement plus ancien ? Sa chute résonne comme une leçon antique : nul pouvoir n’échappe à la mesure.
La justice comme miroir
En condamnant l’ancien président, la République française ne punit pas seulement un individu : elle se contemple elle-même. Elle affirme que nul, fût-il le dépositaire du suffrage universel, n’est au-dessus de la loi. Mais elle révèle aussi sa propre fragilité : la décision arrive presque vingt ans après les faits, quand le souvenir collectif s’efface. Est-ce encore justice, ou simple rituel expiatoire destiné à prouver que le temple tient debout ?
Et si, dans ce miroir, l’idée d’une grâce présidentielle, geste rare mais prévu par la Constitution, venait à surgir ? Non comme effacement d’une faute, mais comme ultime affirmation de la souveraineté républicaine, capable de sévérité comme de clémence.
La dignité comme ultime liberté
Reste un fait que l’on ne peut ignorer : tout au long de ce processus, Nicolas Sarkozy a choisi de faire face. Qu’on partage ou non ses positions, il a comparu, s’est défendu, a contesté sans se soustraire. Dans une époque où tant d’hommes de pouvoir se dérobent ou cherchent refuge dans l’exil médiatique, cette attitude interroge. Camus rappelait que « l’honneur consiste à être fidèle à soi-même » : la dignité n’efface pas la faute, mais elle révèle une forme de grandeur dans l’épreuve. Ici, la liberté se loge peut-être dans ce refus de l’humiliation, et, qui sait, dans l’attente sans calcul d’un éventuel geste de clémence que seul l’État peut accorder.
Au-delà du verdict
La véritable leçon n’est donc pas de savoir si Nicolas Sarkozy est « réellement » coupable. Elle est de constater que tout pouvoir, lorsqu’il confond l’ambition avec l’illimitation, finit par rencontrer ses limites. Comme l’écrivait Camus, « le destin n’est pas une chaîne, mais une force que nous reconnaissons au moment où nous croyions la dominer ».
Partagez













Laisser un commentaire